Retours de flamme

L’Étrange Festival s'est déroulé cette année du 5 au 15 septembre, proposant une sélection plus que jamais éclectique et surprenante.
Afficher une dix-neuvième édition au compteur autorise à se tourner vers le passé. L'Étrange Festival a ouvert sa sélection 2013 à une palanquée d'habitués, réservant une portion un peu plus congrue à la découverte de nouveaux talents. Ce qui aurait causé une déception si ces résidents, qui n'en sont plus à leurs coups d'essai, n'avaient pas apporté les meilleures surprises aux festivaliers.
L’avenir du cinéma ne fut pas pour autant oublié de cette édition, avec la projection en compétition de l'excellent Blue Ruin de Jeremy Saulnier, qui s'accompagnait pour l'occasion du premier long du talentueux monsieur, la découverte d'un très bon film de SF brésilien par un réalisateur inconnu en nos contrées ou la dernière bombe d'Anurag Kashyap, réalisateur des Gangs Of Wasseypur. Les festivaliers de l’Étrange purent également rencontrer Martine Beswick (Dr Jekyll & Sister Hyde) et Caroline Munro (Maniac, Le Septième Voyage De Sinbad), venues présenter leur hommage respectif, et assister à une nuit en l'honneur de Divine, la Diva favorite de John Waters à l'occasion du 25ème anniversaire de sa mort. 
Albert Dupontel profita de la présentation de son dernier film pour nous faire partager son exégèse cinématographique avec une belle sélection de classiques et de courts-métrages. Jello Biafra se réserva quant à lui une carte blanche véritablement extra-terrestre. Mais le plus attendu de tous les invités était certainement le réalisateur coréen Bong Joon-Ho, venu présenter son adaptation du Transperceneige à guichet fermé devant un parterre de spectateurs privilégiés.
L’Étrange Festival, c’est toujours onze jours qu’on ne voit pas passer, traversés d'univers uniques et de films qu’on n’oubliera pas sitôt sortis de la salle obscure. En voici le plus beau florilège.
A FILM TO DIE FOR
Le meilleur film de cette cuvée 2013 est sans aucun doute Why Don’t You Play In Hell? de Sono Sion. Habitué de l'Étrange qui avait eu l’occasion d’y montrer sa tête deux ans auparavant en nous faisant découvrir les inclassables Cold Fish (sorti récemment en DVD et Blu-ray) et Guilty Of Romance, Sono Sion partit ensuite dans des délires post-Fukushima éloignés de ces précédentes œuvres. Son retour à un cinéma rentre-dedans n’en est que plus jouissif et surprenant.
Dans la veine narrative de Love Exposure, le cinéaste japonais croise le destin d’une foultitude de personnages dont les parcours se joindront à un point précis de l’histoire : un groupe de jeunes qui vivent pour le cinéma, deux clans ennemis de yakuzas, une ex-enfant star de pub fille d’un de ces yakuzas et un jeune homme banal qui n’a rien demandé. Sono Sion met tout dans le shaker et il en ressort quelque chose d’unique, de diablement cohérent et surtout une comédie foisonnante comme on a la chance d’en voir peu. Lorsque l’épouse du yakuza sort de prison, celui-ci fera tout pour lui offrir son rêve : faire de sa fille une star, même si cela doit convertir toute la famille en équipe de cinéma ou s’il doit y avoir des morts. Une belle opportunité pour confondre réalité et fiction et réaliser un film en équilibre permanent, peuplé de personnages dingues, autant empêtrés dans leur époque qu’attachants dans leur passion pour mener à bien un projet commun : LE FILM. Rarement enthousiasme aura été aussi communicatif.
Why Don't You Play In Hell ? a très logiquement obtenu le prix du public de cette édition.

FAMILLES MORTELLES
Aux Etats-Unis, comme en Inde ou aux Pays-bas, le ver est dans le fruit : la lente dégradation des rapports familiaux est au centre de trois films de cette édition. Trois portraits de familles au point limite qu’un élément imprévisible va faire imploser.
La première, que l’on découvre dans le film Found de Scott Schirmer, vit dans une banlieue américaine. La vie du jeune Marty, douze ans, fan de comics et de films d'horreur, va basculer suite à la découverte d'une tête humaine dans le sac de son frère. Devenu le souffre-douleur de ses camarades, il perd son meilleur ami et se voit contraint de composer avec des adultes incapables de résoudre ses problèmes. Mais la situation peut encore dégénérer, au point que la vie du gamin se transforme inéluctablement en film d'horreur.

Ce premier film fleure bon la fin des années 80, époque à laquelle il se déroule. Les affiches sur les murs du grand frère, le vidéo-club principal dépositaire du cinéma déviant, l'insinuation d'une criminalité ordinaire exposée dans toute sa crudité le rapprochent d'un Henry Portrait Of A Serial Killer d'un point de vue extérieur (celui du jeune frère du tueur) qui flirterait avec les excès des films d’Andreas Schnaas (Violent Shit). Le milieu du métrage est d'ailleurs marqué par l'irruption du film fictionnel Headless, émanation du cinéma underground ultra-gore qui prit source lors de ces années. A la différence de son frère qui a trouvé dans son jeu de massacre un moyen de se divertir, le héros ressent un malaise profond lorsque des parts de sa réalité rejoignent ce qu'il regarde sur l'écran.
Found s'avère parfois maladroit, en particulier à cause d’acteurs en sur-jeu, le grand-frère en tête, mais n'est jamais meilleur que lorsqu'il immerge le point de vue de l'enfant. Confronté à un monde adulte qui s'impose progressivement à lui via ses pires travers, Marty fait l'expérience de l'injustice, et l'incompréhension finit par se muer en défiance. Il se trouve propulsé malgré lui dans un mauvais film d'horreur, un fait divers sordide, en laissant perdurer la situation de son frère et explosant les germes de la discorde entre ce dernier et sa famille.
Le jeune Gavin Brown porte sur ses frêles épaules tout un univers, qui naît des dessins de super-héros mâtinés de gore rigolard (très beau générique) pour se terminer dans une horreur glaçante.
Notre deuxième famille est hollandaise : un cadre aisé, violent et raciste, sa femme un brin névropathe, leurs mignons petits enfants tout blonds et la fille au pair.
Alex van Warmerdam avait marqué la première édition de l’Étrange Festival avec Les Habitants. Il scelle les retrouvailles avec ce Borgman, qui renoue avec un sens du mystère habilement imbriqué dans une intrigue pseudo-sociale. Camiel Borgman est un vagabond flanqué d’une mauvaise troupe. Lorsqu’il jette son dévolu sur cette famille, il ne la lâchera plus et entamera une intrusion domestique progressive, convoquant ses complices pour l’aider dans cette tâche et convertir mystérieusement les personnages qui gravitent autour du couple.
Borgman fait voler les apparences, mais c’est avant tout une fable à l’humour très noir où on coince les têtes des cadavres dans des pots goudronnés pour qu’ils s'écoulent mieux. Van Warmerdam joue admirablement avec les zones d’ombres de son histoire, dégageant une aura fantastique qui hante même après son final.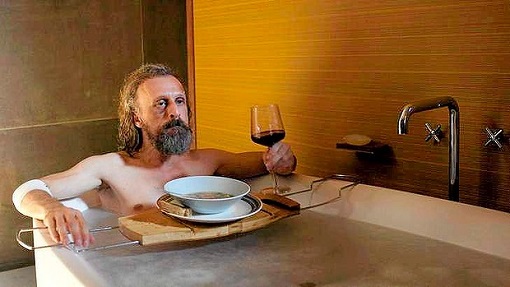
Le réalisateur des Gangs Of Wasseypur revient avec un polar tiré d’une histoire vraie sur la disparition d’une gamine de douze ans, centre de gravité de notre troisième famille. Ugly est un film déroutant, qui ébauche une chronique sociale teintée d’humour pour se muer en enquête noire qui dépasse tellement les intéressés qu’on finit embarqué sur la pire des pistes. Sa première heure rappelle le ton du Memories Of Murder de Bong Joon-Ho en moins mélancolique et beaucoup plus vif. Puis on se concentre sur les proches de la disparue qui tentent de profiter chacun leur tour de l’aubaine de sa disparition tandis que les heures passent, les éloignant toujours plus de la pauvre gamine.
Anurag Kashyap va droit au but, hache le récit, rend les flashbacks peu perceptibles et décrit une Inde perdue et cynique peuplée de personnes viles. Sa réalisation reste moderne et inspirée, toute autant que sa bande son. Ronit Roy, excellent en flic stoïque poursuivi par un trauma d’enfance, mène une distribution sans fausse note encore une fois loin des terres balisées de Bollywood. Ugly porte bien son nom, tant rien de propre ne se dégage de ces deux heures, si ce n’est la confirmation d’un talent.
FRENCH TOUCH
L’Étrange Festival ouvre sa sélection à deux réalisateurs bien connus du public qui prouvent qu’on peut être à la fois français, sous influence et original.
Quentin Dupieux, Mr.Oizo et réalisateur de Steak, Rubber et Wrong, revient avec une nouvelle déclaration d’amour au non-sens : en 2014 à Los Angeles, une bande de flics sévit au-delà des limites de la loi. Dealer d'herbe par rats interposés, le flic Duke tire accidentellement sur son voisin. Il demande à un de ses collègues qu'il fournit d'achever le pauvre homme. Pendant ce temps, un autre utilise sa fonction pour harceler les jeunes femmes, une quatrième s'improvise maître chanteur et un cinquième s'est mis en tête de percer dans la musique.

Wrong Cops est l’adaptation en long-métrage du court-métrage Wrong Cops Chapter I qui adjoint à l'histoire principale des intrigues annexes sur d'autres flics ramassés du bulbe. Débarrassé des à-coté métas de Rubber, le cinéaste se lâche dans un absurde plus accessible et plus immédiatement jouissif. Il laisse se prolonger une scène surréaliste lors d'un enterrement (la meilleure du film), ose filmer une demande de rançon contre un magazine porno ou la confrontation entre un nabab de l'industrie du disque, un type mourant et un flic borgne, le tout dans un esprit frondeur et jusqu'au-boutiste.
Wrong Cops pourrait se résumer à une suite de situations nonsensiques s’il ne possédait pas une forme malgré lui, une arythmie qui fonctionne parfaitement en tant que telle. Son miracle tient en partie dans le fait que Dupieux laisse évoluer ses personnages dans leurs intrigues respectives pour mieux les croiser, les uns devenant pour un temps les personnages secondaires des intrigues des autres. Excellant dans la direction d'acteurs, Dupieux propose un casting aussi parfait qu'improbable (certainement le plus branque depuis Southland Tales) composé entre autres de Marylin Manson, Steve Little, Eric Judor et Jon Lajoie. Il paye ouvertement son tribut à David Lynch par les apparitions de Ray Wise et Grace Zabriskie, parents de Laura Palmer dans Twin Peaks. Le génial Mark Burnham nous offre un personnage mémorable qui fait fi de toutes règles, centre de ce ballet des uniformes qui s'apparente à un Pulp Fiction de l'absurde. A ce jour le film le plus abouti de Quentin Dupieux.
Il peut sembler étrange (!) d'accueillir Albert Dupontel dans un festival qui célèbre le cinéma "déviant" tant son visage semble avoir intégré le cinéma français mainstream. Ce serait oublier l'auteur de Bernie et du Créateur, fan forcené de Brazil et des Monty Python, qui fit partie de la jeune garde des années 90 (avec Noe, Kounen, Jeunet...) et qui apporta un coup de sang neuf dans le cinéma hexagonal par un vent d'inventivité formelle et un intérêt certain pour les sujets de société. Dupontel fit de l'humour noir dénué de scrupules sa spécialité, mâtiné de délires cartoon live surprenants qui se diluèrent dans les propos de ses films suivants.
Neuf Mois Ferme, son dernier né, n'atténue pas ce tournant, mais propose un retour en pointillé à quelque chose de plus proche du Créateur : Ariane Felder est une juge stricte et psychorigide, célibataire endurcie par son enfance. Elle connaît sa place dans la société et la prend tellement à cœur qu'elle refuse toute distraction, sauf en ce nouvel an 2013 où elle boit plus que de raison pour pouvoir supporter ses collègues. Quelques temps plus tard, notre juge découvre qu'elle est enceinte de cinq mois et que le père de son enfant n'est autre qu'un criminel connu sous le nom de globophage. Perturbée, elle provoque une situation qui la confronte à cet homme - qui ignore sa paternité - et lui propose de tout mettre en œuvre pour l'innocenter du crime duquel il est accusé.

Dupontel joue sur la rencontre forcée de deux individus que le système oppose radicalement, un point de départ idéal pour une comédie de mœurs endiablée et militante. Ce n'est pourtant pas dans ce registre que le film fonctionne le mieux, bien qu'il nous offre une confrontation plus que savoureuse entre la juge et le criminel. Il se montre bien plus à son aise dans la description de l'évolution de son héroïne, personnifiée par une Sandrine Kiberlain au top. Attirant naturellement l'empathie malgré son caractère froid, Kiberlain reporte les débordements duponteliens sur les personnages secondaires.
Le réalisateur gère avec les honneurs les ruptures de ton, passant du plus franc délire (tout l'arc avec le juge interprété par Phillipe Uchan, les hypothèses d'un accident) à des scènes franchement émouvantes (le rapport naissant de la juge avec le bébé). Le milieu du droit actuel est décrit avec acuité, peuplé de personnages engoncés dans leur certitude et dans un décorum qui rappelle celui des théâtreux du Créateur. La caractérisation outrancière est aussi de rigueur, et trouve son apogée dans les grands gestes d'un Nicolas Marié génial dans la peau de Maître Tolos, avocat bègue démonstratif et incapable.
TEMPS MORTS
Avides de personnages coincés dans des espaces temporels incertains, votre bonheur n’est pas loin. The Man From The Future est belle petite variation brésilienne sur Retour Vers Le Futur dans laquelle Wagner Moura (Tropa De Elite, Elysium) campe un chercheur en physiques qui remonte le temps pour se retrouver à la soirée qui a décidé de sa vie de loser, la même soirée où la femme qu’il aimait a participé à son humiliation publique.
On est ici sur de la comédie menée à un rythme cadencé sans temps mort. Le réalisateur Claudio Torres fait un travail propre, livrant quelques scènes mémorables et inventives qui n’ont pas à rougir de son affiliation au sous-genre du film à paradoxes (la dématérialisation, les trois versions du héros). Le scénario de The Man From The Future est simple mais malin, le héros évolue constamment et les personnages secondaires gagnent en sympathie à mesure de l’implication dans cette aventure en boucle. Le final, qui remet en question le voyage temporel, est une belle cerise sur le gâteau. Il est regrettable qu’une telle réussite en son pays, aussi bien calibrée pour divertir, n’ait pas trouvé de distributeur dans nos contrées.

Après le voyage dans le temps à la brésilienne, la dilatation du temps à l’anglaise. C’est sous le titre étrange et inapproprié de English Revolution que l’on retrouve A field In England, dernier opus en date de Ben Wheatley (Kill List, Touristes). Imaginez que l’on renomme Le Bon, La Brute Et Le Truand en American Civil War et vous aurez une idée du décalage. Mais la particularité de Wheatley, hormis faire un tour à l'Étrange Festival tous les ans, est de ne jamais concevoir le même film. Sur la forme, il y a un monde entre Kill List, Touristes et A Field In England, et il est probablement aussi difficile de marketter le nom du réalisateur que cet objet filmique peu identifiable.
Wheatley lâche cinq acteurs (dont son inséparable Michael Smiley) en pleine guerre civile avec pour seul décor un champ qui s’étend à perte de vue. Scellant la rencontre de ces hommes de monde différent mais qui n'empêche pas certaines accointances, le cinéaste explore une sorte d’univers parallèle où se jouera autre chose que le film de guerre d’époque auquel on s’attend : un trip intimiste en noir et blanc traversé de fulgurances contemplatives, de moments malsains et un partage en vrille imprévu sur le point de vue d’un des héros qui a trop abusé des champignons hallucinogènes. Un film émouvant, dérangeant et surtout unique.

Vincenzo Natali aime toujours plonger ses personnages dans le vide, les isoler dans d’autres dimensions en leur laissant le loisir de trouver la clé pour s’en sortir. Le réalisateur de Cube teste ici avec Haunter la boucle temporelle. L’aventure de Lisa (Abigail Breslin) commence comme Un Jour Sans Fin pour se poursuivre dans la veine du film d'Amenabar Les Autres lorsqu’elle découvre la vérité sur sa condition de fantôme. Le métrage n'exploite son originalité qu'à partir de sa troisième "couche", lorsque Haunter mute une lutte entre l’adolescente et le fantôme du tueur pour le salut d’une nouvelle famille en danger.
Malgré une première partie ennuyeuse, la jeune Abigail Breslin assure tout du long, la réalisation reste appliquée et Stephen McHattie, excellent comme à son habitude, embaume le film de son aura machiavélique.
MUTANTS ENNEMIS
The Station est un film d’horreur autrichien très premier degré qui, à son humble niveau, rend hommage au The Thing de Carpenter. Marvin Kren, le réalisateur de Rammbock, nous présente un organisme capable de combiner les ADN de la personne attaquée, de l’infecté et de tout autre personne en contact. L’attaqué devient alors incubateur et accouche de belles monstruosités. Autant dire que la fin du monde n’est pas loin.
Le réalisateur plante le décor d’une station de recherche perdue dans la neige et dépeint les hommes et femmes qui y travaillent via une présentation succincte et efficace. Kren ménage les apparitions de ses monstres (sans CGI, et il le revendique) tout en prenant soin de confronter des personnalités intéressantes, parmi lesquelles une ministre de poigne. Le rapport entre le héros, Janek, et son chien fait office de socle émotionnel qui permet à The Station de passer du grade de la série B agréable à la bobine fantastique qu’on aimerait revoir dans une salle de cinéma à l’occasion. Il faudra en tout cas garder un œil sur Marvin Kren.

PALMARÈS
PRIX NOUVEAU GENRE : The Major de Yuri Bikov. Un choix plutôt consensuel, qui peut s’expliquer par le fait qu’il bénéficiera, comme les précédents primés Buried, Bullhead et Headhunters, d’une diffusion sur Canal + Cinéma.
PRIX DU PUBLIC : Why Don’t You Play In Hell? de Sono Sion.
PRIX DU COURT- MÉTRAGE JURY et PRIX DU COURT-MÉTRAGE PUBLIC : le splendide The Voice Thief d’Adan Jodorowsky.

