Dûˋmineurs
- Dûˋtails
- Critique par Guûˋnaû¨l Eveno le 28 septembre 2009
Danse avec la mort
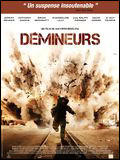
"War is a drug". Il nãyãa pas besoin de plus de trois mots pour rûˋsumer le shot dãadrûˋnaline qui annonce le grand retour de Kathryn Bigelow dans nos salles au terme de plusieurs annûˋes de sevrage forcûˋ. Attention, Dûˋmineurs provoque une nouvelle accoutumance.
Bagdad, au céur du conflit irakien. Dûˋmineurs de profession, Sanbord et Eldridge doivent composer avec un nouveau chef, le sergent William James. Tûˋmûˋraire au point de souvent faire cavalier seul, celui-ci ne tarde pas û entraûÛner le groupe dans des situations de plus en plus risquûˋes.
Basûˋ sur lãexpûˋrience du journaliste (et co-scûˋnariste pour l'occasion) Mark Boal au sein dãune unitûˋ de dûˋminage, The Hurt Locker (titre amûˋricain du film, bien plus appropriûˋ) prend pour contexte la guerre en Irak. Il ne va cependant pas sãûˋtendre sur les implications politiques du conflit. Dûˋmineurs parle de la guerre de maniû´re universelle, et û travers son sujet, Bigelow ûˋnonce les effets pervers de toute guerre moderne sur les hommes. Qui souhaite un panorama exhaustif et formellement proche de Dûˋmineurs des tenants et aboutissants du conflit Irakien devra se tourner vers lãexcellente sûˋrie Generation Kill de Simon et Burns (les gars derriû´re Sur Ecoute pour ceux du fond). Reste que lãIrak est un bon contexte, un lieu de chaos dans lequel les protagonistes devront ûˋvoluer au sein dãun ûˋquilibre prûˋcaire alors que leur vie se joue û chaque instant. Par leurs missions, par lãalûˋatoire des mines, par le climat dûˋsertique et chaud, par la mûˋfiance des autochtones, par les opposants dûˋguisûˋs en civils qui peuvent les anûˋantir en appuyant sur la touche dãun portable et les kamikazes, ils sont constamment exposûˋs û un danger de mort violente. Pour preuve de cette menace, un dûˋcompte des jours en guise de chapitrage, un but û atteindre sans se faire tuer qui fait ressentir chaque jour comme un sursis supplûˋmentaire.
La rûˋalisatrice nous prûˋsente ûˋgalement de nouveaux visages, renforûÏant lãidentification des acteurs û leur rûÇle et envoyant voler les certitudes que des "noms" auraient pu laisser subsister sur la capacitûˋ des personnages û connaûÛtre û tout moment lãissue fatale (elle profite ûˋgalement de ses premiers couteaux pour contredire de maniû´re fulgurante cette certitude cinûˋmatographique). Dans ces conditions dãincertitude, lãadrûˋnaline ne peut que monter trû´s haut. Nãayant pu tourner en Irak, Bigelow se rabat sur le Koweit et la Jordanie afin de rendre au mieux lãaspect ûˋtouffant que le spectateur ressent û la vision des reportages sur la guerre, des images dûˋjû imprûˋgnûˋes sur nos rûˋtines et qui identifient encore plus nettement le danger. Aprû´s avoir ûˋtûˋ poussûˋ dans ses derniers retranchements par toutes sortes de lieux hostiles (la mer, le jour, le sous-marinãÎ), le hûˋros Bigelowien avide de sensations est fin prûˆt û se dûˋcouvrir une nouvelle jeunesse sur ce terrain de guerre, dans la sûˋcheresse d'une ville qui se nourrit de la mort.

LE SALAIRE DU DANGER
Privilûˋgiant lãexpûˋrience intime comme pour ses prûˋcûˋdents mûˋtrages, la rûˋalisatrice nous plonge durant plus de deux heures dans le quotidien des trois dûˋmineurs, nous forûÏant û enfiler le casque (et la peau) de ces hommes. Dans un scûˋnario û la structure atypique, elle aligne les scû´nes de mission, vûˋritables minis climax dûˋveloppant leurs propres enjeux et leur propre tension interne mais ne constituant jamais une rûˋpûˋtition, puisquãamenûˋes û rûˋvûˋler au céur de lãaction de nouvelles facettes des personnages. Pour nous faire ressentir les montûˋes dãadrûˋnaline, la rûˋalisatrice use de tous les outils û sa disposition. Que ce soit par un suspens qui sãûˋtire, un montage efficace qui rappelle constamment la menace (particuliû´rement rapide sur la scû´ne de la bombe humaine), une vûˋritable immersion au céur dãexplosions violentes, des plans au plus prû´s de lãhomme qui soulignent le dûˋtail des opûˋrations et la conviction dãacteurs qui ne simulent pas leurs gestes. Ceux-ci ont en effet ûˋtûˋ entraûÛnûˋs pendant le tournage dans un camp dãentraûÛnement de Californie afin de saisir la pleine difficultûˋ de lãexposition, de prendre conscience de la difficultûˋ de gûˋrer en peu de temps la pression de prises de dûˋcisions qui peuvent mener û la mort. La rûˋalisatrice insiste particuliû´rement sur lãacquisition de ces donnûˋes psychologiques et fort bien lui en a fait. Lorsque nous sommes dans ces scû´nes, impossible dãûˆtre ailleurs. On ne voit plus la guerre, ni la mission, on voit un homme face û lui-mûˆme et chacun de ses gestes est sujet û tension. Une tension qui transporte dans lãinstant prûˋsent et rappelle les meilleurs moments du Salaire De La Peur de Clouzot et de son remake Sorcerer. Il est impressionnant de constater que la belle a encore des leûÏons û donner, vingt ans aprû´s Point Break, dans lãimplication pro et personnelle avec des dûˋlais de tournage aussi serrûˋs (neuf semaines) et un budget de onze millions de dollars lorsque des blockbusters sont confiûˋs û des rûˋalisateurs qui ne maûÛtrisent pas le quart de ces techniques et entretiennent inconsciemment une distance opaque avec le spectateur.

DûMINEUR ET SOLITAIRE
Bigelow sãintûˋresse û chacun des membres du groupe, qui reprûˋsente une vision archûˋtypale de la maniû´re de gûˋrer le mûˋtier, mais le point de vue de William James, incarnûˋ avec brio par Jûˋrûˋmy Renner (la rûˋvûˋlation du film) occupe dû´s son arrivûˋe le plus gros du film. Il est le pû´re de famille que lãIrak dûˋconnecte du monde au point de ne plus lui permettre de doser les risques pris. Dû´s la premiû´re scû´ne, on sãidentifie au premier chef, et le passage de flambeau avec James se fera par une mise en place de la vision subjective, proche de celle opûˋrûˋe par les POV sequences de Strange Days. Se jetant dû´s le dûˋpart dans la mûˆlûˋe et dûˋfiant un conducteur, faisant fi des procûˋdures de sûˋcuritûˋ, il est ce hûˋros insolent typiquement amûˋricain que Bigelow se plaûÛt û suivre dans nombre de ses films. Un cow-boy des temps modernes faussement û lãaise mais parfaitement û sa place dans ce rûˋalisme mûÂtinûˋ de western. Le western en vient mûˆme û contaminer une scû´ne de fusillade dans le dûˋsert, tant on sãattendrait û voir surgir des Apaches dans le dûˋsert irakien.

La rûˋalisatrice exploite une maniû´re subtile de nous montrer les effets des "shoot" d'adrûˋnaline sur son hûˋros, û la fois sources de douleur et d'extase mais aussi d'enfermement, qui rappelle la spirale de Caleb dans Aux Frontiû´res De L'Aube. Par la rûˋpûˋtition des menaces, elle installe le quotidien propice û la dûˋpendance. Par la camaraderie virile qui s'installe entre les trois hommes, elle nourrit le besoin de se rapprocher d'un personnage au dûˋpart trû´s obscur sans dûˋvoiler ses tortures par de longues discussions inutiles. Au sein des sûˋquences de dûˋminage, des intermû´des intimistes, de ces virûˋes urbaines sous tension ou dans ce superbe plan final dans lequel le lonesome cow-boy marche inexorablement vers la mort û la maniû´re d'un Bodhi dans le final de Point Break, on ressent l'abandon total de James û sa drogue. Un abandon clairement soulignûˋ dans les derniû´res scû´nes par l'abdication de son rûÇle social, plus tempûˋrûˋ que celle de Christopher Walken dans Voyage Au Bout De L'Enfer, mais pas moins irrûˋversible. Cette poignûˋe de minutes quotidiennes au retour de la guerre constitue le seul dûˋfaut du film, faisant effet de redondance d'une thûˋmatique qui ûˋtait dûˋjû claire dû´s la premiû´re image. Il est nûˋanmoins difficile de tenir rigueur de ce dûˋfaut lûˋger û la vue du rûˋsultat. Dûˋmineurs est sans nul doute le film sur la guerre le plus inspirûˋ depuis des annûˋes et le film le plus immersif que 2009 ait eu û nous offrir. Quand on sait que le prochain film de la belle sera un polar, il y a de quoi saliver.
THE HURT LOCKER
Rûˋalisatrice : Kathryn Bigelow
Scûˋnario : Kathryn Bigelow, Mark Boal
Production : Kathryn Bigelow, Mark Boal, Nicolas Chartier, Greg Shapiro
Photo : Barry Ackroyd
Montage : Chris Innis, Bob Murawski
Bande originale : Mrco Beltrami, Buck Sanders
Origine : USA
Durûˋe : 2h04
Sortie franûÏaise : 23 septembre 2009ô
