Cannibal Holocaust
- Dûˋtails
- Analyse par Clûˋment Arbrun le 19 juillet 2012
ûteindre la camûˋra
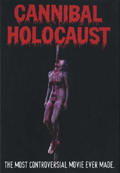
"Pendant le tournage, je me souviens que lãinvention ûˋtait permanente, la violence que jãavais en moi ûˋtait tellement puissante quãelle me procurait une ûˋnergie ûˋnorme, une confiance en tout ce que je tournais. Je venais de divorcer, lãItalie ûˋtait en plein chaos, avec la corruption, les attentats, les enlû´vements, lãassassinat dãAldo Moro en 1978, etc."
Cannibal Holocaust est le fruit des annûˋes de plombô : durant les annûˋes soixante-dix, les Brigades Rouges, organisations dãextrûˆme gauche, "terrorisent" lãItalie. Les victimesô : de simples citoyens, des policiers, des journalistes, des politiciens, des magistrats. Enlû´vements, sûˋquestrations, attentatsãÎ des deux extrûˆmes (droite comme gauche) la violence se propage. Comme lors de chaque chaos social, ces ûˋvûˋnements se doiventô dãûˆtre captûˋs û lãarrachûˋ par la toute puissance mûˋdiatique, avec le sens du devoirô que cela impliqueô : dans ce contexte, le cinûˋaste Ruggero Deodato se demande alors pour quelles raisons la violence serait censurûˋe au cinûˋma, puisquãelle imprû´gne chaque jour lãûˋcran de tûˋlûˋvision, au quotidien. Son jeune fils, chaque heure, y est harcelûˋ par le flot dãimages sanglantes, de cadavres filmûˋs en toute intûˋgritûˋ journalistique. Le sens du choc excusûˋ par la puissance de la vûˋritûˋ. Une seule solution, la seule solution existante pour lutter contre toute overdose mûˋdiatiqueô : ûˋteindre la tûˋlûˋvision.ô Et faire du cinûˋma.

A lãûˋpoque, Deodato nãen est pas û son premier film. Cet ûˋlû´ve de Rosselini (lãun des grands noms du nûˋo-rûˋalisme italien) sãapprûˆte û effectuer un tournant dans sa carriû´re, puisquãencore aujourdãhui il considû´re Cannibal Holocaust comme le film-somme de toute une vie, de tout un art.
Comme le Massacre A La TronûÏonneuse de Tobe Hooper, cãest un titre mythique qui donne lãimpression dãûˋcraser son crûˋateur. Deux films sociaux û vrai dire, lãun comme lãautre ûˋtant caractûˋristique du malaise de la sociûˋtûˋ qui leur donnûÂt vieô : le traumatisme Charles Manson (en pleine û´re hippie) inspire les atrocitûˋs de Leatherface, lãultra-violence gangrenant la sociûˋtûˋ italienne, toujours enregistrûˋe par les camûˋras sans once de recul et avec moult travellings avant, enveloppe chaque instant polûˋmique de cet "holocauste cannibale". Ce quãil y a dãintûˋressant, cãest que cãest cette envie de critique qui donne naissance au film, alors que le film lui-mûˆme, dans son processus, est hautement critiquable. Il sãhabille de lãimmoralitûˋ quãil dûˋnonce et ce par une logique militante, en usant du procûˋdûˋ de found footage comme immersion totale dans lãinnommable.
Pas grand-chose û en tirer, au dûˋpart, si ce nãest un schûˋma de film bis ritalô : lãexotisme dãune virûˋe dans lãenfer vertô oû¿ se rend un chercheur et toute une troupe de guides pour retrouver de jeunes fougueux journalistes qui se seraient ûˋgarûˋs dans ce labyrinthe forestier. Trû´s vite il ne fait aucun doute que ces reporters ont ûˋtûˋ victimes de la population cannibale, aux rites particuliers et aux pratiques barbares, une population quãil faut imiter pour survivre. Mais de retour û New York, notre savant dûˋcouvre avec stupeur que les majors de la tûˋlûˋvision dûˋsirent diffuser û une heure de grande ûˋcoute le documentaire de lãannûˋe, soit les rushes de cette expûˋdition filmûˋe en nature agressive qui aboutit au massacre de ces journalistes, devenus squelettes rongûˋs par les vers. Lãhorreur nãest plus du bon cûÇtûˋô : si le peuple cannibale respecte une certaine ûˋthique, un rû´glement qui leur est propre, la vûˋritable "humanitûˋ"ô se rûˋvû´le animale. Lãenfer vert ce nãest pas quãun royaume dãinsectes ou quãune menace primitiveô : cãest lãhomme qui le rend infernal en y faisant sa terre de colon, lãhomme ûˋtant ici, plus prûˋcisûˋment, le journaliste. Cãest ce que va comprendre le personnage principal / le spectateur en visionnant le fameux documentaire.
En tant que cinûˋaste, Deodato dûˋcide non pas de tout miser sur la mûˋtaphore, la subtilitûˋ ou la peur subjective, mais de confondre le bourrinageô intensif de la manipulation mûˋdiatique û celui de la manipulation cinûˋmatographique. C'est-û -dire que dans les deux cas (cette violence jamais analysûˋe par une tûˋlûˋvision qui devient voyeuriste, et la critique de cette violence dans le filmô !) lãimage est forcûˋment explicite, frontale, perverseô : de lãimage-CHOC. Oliver Stone sãest fait massacrer par une grande partie de la presse (et ce encore aujourdãhui) puisquãen proposant son Tueurs Nûˋs (1994), exercice de style aux multiples expûˋrimentations visuelles, il se noyait prûˋtendument dans ce quãil pointait du doigt. Sa comparaison camûˋra TV / Ted Bundy ûˋtait le concept-mûˆme du film, une overdose dãagression dûˋlirante qui, par ses intentions, û du influencer le jeune metteur en scû´ne franûÏais Matthieu Kassovtiz, qui, quelques annûˋes plus tard sãattaquait au caractû´re dûˋcervelûˋ de la tûˋlûˋ-poubelle avec Assassin(s) (1996). Bien des annûˋes auparavant, Deodato faisait non pas de la violence tûˋlûˋvisuelle son sujet, mais cãest son film qui devenait la violence.

HORREUR-RûALITû
Lãambiguû₤tûˋ artistique (qui est aussi la force principale du tout) cãest donc ce dûˋfi artistique casse-gueule, qui est dãimposer la virulence et la transgression par une éuvre super-contradictoireô ! Puisque tout ce qui entoure le film ne peut ûˆtre vu que comme une promotion intense (cette rumeur dûˋfinissant le film comme un snuff-movie intûˋgral, aux acteurs rûˋellement morts durant le tournage, la provocation un peu simpliste qui est celle de la barbarie "plus vraie que nature" se vendant par son caractû´re censurûˋ de chez censurûˋ), puisque lãéuvre en elle-mûˆme, par ses extrûˆmes, peut nãûˆtre vue que comme un condensûˋ spectaculaire dãidûˋes sanglantes gratuites, et, enfin, puisque lãidûˋe mûˆme de montrer cette violence sans la dûˋcortiquer est un principe aussi sensationnelô que ce que Deodato satiriseãÎ A savoir, tous ces producteurs qui voient en un immonde reportage de lãinûˋdit "û sensations", de la vûˋritûˋ. De la rûˋalitûˋ nûˋcessaire. Or, lãidûˋe mûˆme du nûˋo-rûˋalisme italien, cãest de sãappuyer sur la rûˋalitûˋ, le monde vrai, par le cinûˋma (et donc par la fiction, le factice), et Deodato lui-mûˆme voit en son ouvrage du "nûˋo-rûˋalisme gore". La voici, toute la complexitûˋ de lãartiste.
Si Deodato mûˋlange voyage exotique peu sûˋduisant (une plongûˋe ûˋtouffante dans une fournaise tropicale terrible), typiquement fictionnel (humour, scûˋnario, personnages caricaturaux amenant le recul) et faux-documentaire (docu-menteurô !), cãest pour mieux brouiller les pistes et troubler la lûˋgitimitûˋ de son éuvreô !

Car, sinon, pourquoi la sublime musique de Riz Ortolani serait-elle utilisûˋe û deux moments distincts, soit au tout dûˋbut du film (donc dans sa premiû´re partieô : le dûˋbut dãun film dãaventures au fin fond du monde) et dans sa deuxiû´me moitiûˋ, soit dans ces oripeaux de snuff, de film archivûˋ en manque de bobines et de sonô ? Pourquoi, si ce nãest pour mieux flouer la frontiû´re entre le vrai et le fauxô ? De la mûˆme maniû´re, il y a cette anecdote fameuse qui rappelle la vûˋracitûˋ des meurtres dãanimaux. Repas de lãûˋquipe du film, une tortue et un porc ont ûˋtûˋ dûˋcapitûˋs, ûˋviscûˋrûˋs, tranchûˋs. Intûˋressûˋ par lãimpact du rûˋalisme, Deodato profite de nãimporte quoi pour ûˋpater par lãapanage de la violenceô : pourquoi filmer minutieusement, longuement, avec force zooms, ces tortures animaliû´resô ?
Ce qui pose souci nãest pas ce qui est fait mais la matiû´re de faire et de montrerô : la camûˋra dûˋvore tout. En sãattardant sur la tûˆte encore gigotante dãune tortue dûˋcapitûˋe, Deodato nãen finit pas de marier sa critique û ce quãil critiqueãÎ Son approche de la violence est celle des mûˋdias, elle se montre "neutre" (car documentaire) et est manipulatoire. Sauf que la violence, dans Cannibal Holocaust, est (fort heureusement) presque totalement fausse, jouûˋe, incarnûˋe. Du superficiel. Mais chez Deodato aussi, "le sens du choc est excusûˋ par la puissance de la vûˋritûˋ". La vûˋritûˋ, cãest de montrer en ces mûˋdias de nouveaux "sauvages" bien plus absurdement primaux que ces cannibales.
Le titre outrancier du film fait penser û une norme des valeursô : le cannibale brutaliserait le civilisûˋ. Or, cãest le civilisûˋ qui tue et viole, pour le succû´sô et lãargent, et non par rite sempiternel. Lãaura, la cûˋlûˋbritûˋ. Cette morale en rûˋaction û dãimmoraux personnages, soit de jeunes loups friands dãestime qui thûˋûÂtralisent lãhorreur, apparaûÛt û lãintûˋrieur dãun dûˋluge de sûˋquences tout bonnement dûˋgueulasses, afin que le spectateur finisse aussi gûˆnûˋ que cette productrice qui, û la fin dãun film, ne peut plus masquer son malaise. Oui, comme les reporters dûˋnuûˋs de conscience dans le film, Deodato empoigne fermement sa camûˋra, et veut tout montrer.
La victoire revient finalement au cinûˋaste qui est parvenu û instruireô son spectateur par le matraquage, le jeu du "Tu nãen peux plusô ? Et bien, û un moment ou û un autre, tu ne pourras plus dûˋtourner la tûˆteô !".

Puisquãen fin de compte, cãest en accumulant les gros plans dûˋgueux, les viols par silex, les acharnements ûˋpoustouflants de la violence, quãû force de dûˋgoû£ts, le rûˋalisateur progresse dans son envie de banaliser cette mûˆme violence aux yeux du public, comme le fait la tûˋlûˋvision en transformant le fait divers le plus sordide en attraction gûˋniale et palpitante du dimanche soir. Cette mise en abûÛme est au céur de Cannibal Holocaust, lãanti-film dãhorreur suggestif.
Mise en abûÛme constante puisque sa fameuse deuxiû´me partie est quasiment entiû´rement filmûˋe de la mûˆme maniû´re (et û plusieurs camûˋras), mais cãest une musique romantique qui est ajoutûˋe durant une scû´ne de sexe cûÂlineãÎ Dans le rûˋcit, le reportage en pleine nature devientãÎ du cinûˋmaô ! Et entre ces quelques instants peu ragoû£tants, interviennent quelques retours û New York, dans la salle de projection notamment, que lãon pourrait tout bonnement appeler des entractes. Lãhistoire du film en soit est particuliû´reô : raconter lãhistoire dãun scientifique parti explorer les terres indigû´nes, et revenant û la civilisation pour dûˋcouvrir un film de cette mûˆme civilisation, film qui doit devenir du cinûˋma û sensations pour ûˆtre diffusûˋ. Comme un cinûˋaste de la Nouvelle Vague, cet expert du gore quãest Deodato joue avec son histoire. Pourtant, contrairement û une multitude de films de genre mûˋtas û lãenvi (la gûˋnûˋration Kevin Williamson), lãhorreur du film nãest jamais dûˋcrûˋdibilisûˋe ou dûˋdramatisûˋe par lãaspect intra-textuel de lãensembleãÎ
En terme de conclusion, il reste le silence du public dans le film et celui du public du film, comme tûˋtanisûˋ par lãhorreur. Mais la chute dûˋnote un certain optimismeô : Deodato a rûˋagit û lãinconscience des mûˋdias, et, finalement, ces mûˋdias, û la fin de lãhistoire refusent de diffuser ce film. Lãimpression que tout nãest pas perdu. Et encore une fois intervient la mûˋlodie de Ortolani, parfait contrepoint musical, du dûˋcalage que nãaurait pas reniûˋ un cinûˋaste comme Rainer Werner Fassbinder, lui aussi friand de lãironie quãapporte le rapport contradictoire autant que complûˋmentaire entre la musique et lãimageãÎ

Encore de nos jours, û lãheure du torture porn aux prûˋtentions parfois dûˋrisoires (le cas Martyrs), Cannibal Holocaust choque volontiers, mais ne surprend pas tant par cet excû´s de mises û mort que par lãoutrancier catûˋgorique de son concept, oû¿ la forme se mûˆle au fond dans une optique de non-retour, oû¿ cãest lãassoiffûˋ dãimages qui vient sãen prendre plein la face pour mieux douter de lãexistence de sa propre rûˋflexion face au flot continu des sûˋquences manipulatrices. Et le metteur en scû´ne dãûˋteindre sa camûˋra pour mieux nous encourager û en faire de mûˆme avec notre cher tube cathodique.
Les propos de Ruggero Deodato proviennent du numûˋro 3 de la revue Panic.
CANNIBAL HOLOCAUST
Rûˋalisateurô : Ruggero Deodato
Scûˋnario : Ruggero Deodato & Gianfranco Clerici
Montageô : Vincenzo Tomassi & Ruggero Deodato
Productionô : FD Cinematografica
Photographieô : Sergio dãOffizy & Ruggero Deodato
Bande originaleô : Riz Ortolani
Origineô : Italie
Durûˋeô : 1h38
Sortie franûÏaiseô : 22 avril 1981
